Mon compte
Interview THANH-VAN TRAN-NHUT
En complément

TEMPLE DE LA GRUE ECARLATE (LE)
Dès cette première aventure, les sœurs Tran-Nhut déploient tout leur talent : de...
10.00 €

OMBRE DU PRINCE (L')
Ce deuxième volet poursuit habilement les aventures du jeune mandarin Tân. Les p...
9.00 €

POUDRE NOIRE DE MAITRE HOU (LA
Ce troisième tome des aventures du mandarin Tân et de ses collègues est peut-êtr...
9.00 €

AILE D'AIRAIN (L')
Des goules, des légendes, des con tinh… rien ne manque dans ce bon polar, mené d...
9.00 €

ESPRIT DE LA RENARDE (L')
Humour, scènes de bravoure, histoire, culture, religion, gastronomie… sont au re...
9.00 €

TRAVERS DU DOCTEUR PORC (LES)
Bien que le mandarin Tân et son fidèle ami le lettré Dinh nous manquent (ce qui ...
8.50 €
Alors, première question, comment vous est venue cette idée d'écrire du
polar ?
J'ai toujours aimé raconter des histoires. Mais le polar s'est imposé
parce que c'est un genre qui allie le jeu avec la logique. C'est non
seulement un jeu de piste avec le lecteur, mais également un jeu de
construction pour l'auteur. Imaginez un château, solide et vaste, qui
serait composé de labyrinthes, de culs-de-sac, d'escaliers dérobés, de
passages secrets. C'est là-dedans qu'il faut emmener le lecteur - pour
le perdre, mais aussi pour qu'il voie d'en haut des remparts le paysage à
ses pieds, qui est le mystère qu'on vient de résoudre.
Et pourquoi à quatre mains ?
L'idée initiale d'écrire un roman policier est venue de ma sœur Kim, qui
voulait sans doute se trouver une complice dans l'affaire. Pour le
premier roman, il était plus rassurant d'avoir quelqu'un avec qui
discuter du scénario et partager l'écriture.
D'ailleurs, dans ce cas, comment s'articule la création ? L'écriture ?
La première chose à trouver, c'est le scénario. Celle qui a élaboré un
scénario complet le présente à l'autre pour validation : c'est à ce
moment que doivent s'éliminer les trous de l'histoire. La trame peut
également être enrichie et des personnages supplémentaires font
éventuellement leur apparition. A partir d'un scénario ficelé, nous
effectuons un découpage des scènes, qui donneront les chapitres. Après,
il suffit de faire son choix des chapitres à écrire et de s'y atteler !
Bien sûr, il y a un travail de relecture et de lissage à la fin, ce qui
permet de brouiller les pistes. Normalement, le lecteur ne doit pas être
en mesure de deviner qui a écrit quoi.
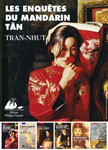 Pourquoi situer ces enquêtes à cette période
plutôt qu'une autre ? On sent d'ailleurs une véritable volonté d'y
ancrer vos livres car le décor et le contexte historiques sont loin
d'être là pour le « folklore » comme dans certains « policiers
historiques ».
Pourquoi situer ces enquêtes à cette période
plutôt qu'une autre ? On sent d'ailleurs une véritable volonté d'y
ancrer vos livres car le décor et le contexte historiques sont loin
d'être là pour le « folklore » comme dans certains « policiers
historiques ».
Nous avons choisi le XVIIe siècle parce que c'est un siècle
d'effondrement et d'ouverture. Face à la corruption ambiante et aux
luttes de pouvoir entre deux familles puissantes du nord et du sud, le
système confucéen est en train de s'écrouler, tandis que l'arrivée des
Européens le sape encore davantage avec l'introduction d'une nouvelle
religion. L'exploitation économique par des puissances extérieures
devient de plus en plus réelle, et une guerre civile est sur le point
d'éclater. Cela semble familier ? Effectivement, pour moi, tout
l'attrait de cette époque provient de cette situation explosive qui
annonce non seulement la colonisation française, mais aussi la guerre du
Viêt-Nam avec la scission nord-sud. Trois siècles plus tôt, cette
guerre avait déjà eu lieu.
Vous faites visiblement beaucoup de recherches pour écrire vos livres.
Ce souci du détail, qui vous honore, c'est votre formation scientifique
qui ressort ?
Bien sûr, ma formation scientifique y est pour beaucoup de choses. Elle
m'a appris l'importance de la précision et de l'honnêteté
intellectuelle. Etre précis veut dire qu'en dehors de la licence
poétique, on ne raconte pas n'importe quoi au lecteur. L'honnêteté
intellectuelle demande qu'on cite ses sources, car on est redevable à
ceux qui ont fait des recherches sur lesquelles on s'appuie.
Vous sortez 4 livres en 4 ans, le rythme ne mollit pas, dites donc...
vous écrivez vite ?
C'est vrai que j'écris relativement vite, mais quand on tient une
histoire, on a tellement envie de la raconter que cela vient sans trop
de douleur. C'est un plaisir sans nom que de pouvoir faire fonctionner
son imaginaire et de rassembler toutes les choses vues, lues ou
entendues dans une seule trame qui arrive à tenir debout.
Présentez-nous un peu les personnages...
Le personnage principal, c'est évidemment le mandarin Tân, dont la
particularité est d'être profondément confucéen, donc respectueux des
traditions. Il est beau, athlétique et gourmand. Il tombe facilement
amoureux mais, pour diverses raisons, a du mal à concrétiser. Cela dit,
notre magistrat est doté d'une bonne dose d'intelligence même si,
quelquefois, il a l'air de ne pas savoir ce qui lui arrive pendant le
déroulement de l'enquête. Il y a certes le Mandarin Tân, mais le lettré
Dinh, le docteur Porc, parfois même les deux porteurs (Minh et Xuân),
tous ont un grand rôle et de l'importance dans ces quatre aventures...
Le lettré Dinh est là pour égarer le mandarin Tân par ses intuitions
souvent scabreuses. Il a une aversion marquée pour le confucianisme, et
constitue donc un contrepoids aux convictions de son ami. Le lettré
représente toute la composante fantasque, frivole et individualiste que
condamne le confucianisme. Le docteur Porc est le dépositaire d'un
savoir médical très utile pour les enquêtes, et aussi l'incarnation du
mauvais goût (et de la mauvaise haleine). Irrespectueux et sans-gêne,
c'est le personnage idéal pour se moquer des conventions de l'époque.
Les porteurs permettent d'avoir une vision des gens du peuple, avec
leurs superstitions et leur humour salace. Leur fidélité au mandarin
démontre également que le mandarin Tân est juste avec ceux qui le
servent.
 Une des constantes, aussi, c'est la nourriture...
On y trouve bon nombre de recettes raffinées... Alors, vous êtes deux
épicuriennes, ou sont-ce juste vos personnages ?
Une des constantes, aussi, c'est la nourriture...
On y trouve bon nombre de recettes raffinées... Alors, vous êtes deux
épicuriennes, ou sont-ce juste vos personnages ?
Les recettes raffinées illustrent l'inimaginable palette d'ingrédients
des cuisiniers viêts ! Les matières premières sont diverses et variées,
et portent des plumes, des poils, des piquants, des écailles... S'il y a
quelque chose qu'on peut affirmer, c'est que le cuisinier viêt n'a peur
de rien, et se montre éclectique dans ses courses. Pour ma part, je
suis gourmande et curieuse. L'un des plaisirs que je tire de mes
voyages, c'est justement la découverte des mets locaux. Plus c'est
étrange, plus ça m'attire !
Les noms sont aussi « traduits » (Docteur Porc, Madame Jade...),
pourquoi ? Et pourquoi n'avez-vous pas « traduit » le vôtre ?
En fait, le docteur Porc est le seul personnage masculin dont le nom a
été traduit. En règle générale, les hommes portent des noms viêts (Dinh,
Thiên...) et les femmes des noms traduits (Madame Aconit, Madame
Libellule, Madame Perle...), car les prénoms féminins possèdent une
certaine poésie qu'il me semblait intéressant de faire ressortir. «
Tran-Nhut » traduit... J'ignore ce que cela donnerait, mais je crains
que ce ne soit pas très poétique !
Et les techniques de combats, qui sont bien
expliquées... vous pratiquez, ou vous avez un "conseiller
technique" ?
Non, je ne pratique pas, mais je regarde souvent des films d'action. Et
l'imagination aidant, j'arrive à concocter des prises mortelles et des
bottes secrètes qui font mal là où il faut. C'est d'ailleurs l'un des
moments d'écriture que j'affectionne particulièrement, car je peux
délirer à loisir.
En 4 aventures, Tân, ne vieillit pas... Vous comptez faire d'autres
épisodes avec lui à cette époque, ou envisagez-vous de le faire vieillir
?
Forcément, le mandarin Tân devra vieillir. Ce n'est pas tant la
vieillesse qui me chagrine, mais le fait qu'il faudra, à un moment ou un
autre, lui faire rencontrer la femme de sa vie. Parce que jusqu'à
présent, je me suis surtout amusée à le montrer dans des situations
amoureuses un peu loufoques, dont il ne sort pas toujours grandi. Or,
les histoires d'amour, ce n'est pas vraiment mon domaine de
prédilection... Donc, à mon avis, notre mandarin a encore de beaux jours
de célibat devant lui.
En revanche, il vacille dans sa vision du confucianisme...
C'est vrai que j'avais à cœur de montrer cette évolution mentale, plus
cruciale encore qu'une évolution physique. Au fil de ses aventures, le
mandarin va de doute en désillusion, et le magistrat novice qu'il était
dans « Le temple de la grue écarlate » perdra inexorablement sa superbe
et ses convictions. Le confucianisme, pierre angulaire du monde d'alors,
garantit la stabilité de la société en mettant en avant le devoir
collectif au détriment de la liberté individuelle. Or, ce système n'est
défendable que si l'on suppose que l'empereur et toutes les strates de
la société sont incorruptibles. Ce qui est loin d'être vrai. Au cours de
ses enquêtes, le mandarin s'apercevra que les crimes commis trouvent
leur raison dans la perversion d'un tel système, et cela l'obligera à
questionner le fondement même de la justice, qui est sa raison d'être.
Explorons plus en détail vos livres...
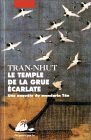 Le temple de la grue écarlate
Le temple de la grue écarlate
Ce premier livre sort chez Picquier... c'est le seul éditeur que vous
ayez contacté? Etait-ce un rêve d'être publié chez lui ?
Je crois que nous avions envoyé le manuscrit à 2 autres éditeurs, qui
n'avaient pas de collection pouvant accueillir les enquêtes du mandarin.
Mais Philippe Picquier, qui n'avait pourtant pas de collection polar
historique, n'a pas hésité à nous publier hors collection, lui !
Evidemment, c'était formidable parce que je me rends compte aujourd'hui
que se faire publier est loin d'être un jeu d'enfant.
Visiblement, vous n'êtes pas traduite au
Vietnam, mais on trouve de bonnes photocopies de vos livres... vous nous
en dites un peu plus...
J'aimerais beaucoup que les Viêts lisent les enquêtes du mandarin Tân,
parce qu'ils sont friands d'aventures avec de la baston. Dans le temps,
il existait des séries fleuves d'histoires de héros chinois avec des
super pouvoirs, dont on attendait impatiemment les traductions en
viêtnamien. En fait, j'ai vu pas mal de bonnes photocopies d'ouvrages
comme des guides de voyage, mais pas encore des nôtres. Si les Viêts
n'ont pas l'air de trop se soucier des droits d'auteur, c'est sans doute
parce que les livres doivent coûter cher là-bas...
Quel fût l'accueil du public ?
Le premier livre a été bien accueilli, parce que c'était la première
fois qu'on voyait une enquête se déroulant dans le Viêt-Nam du XVIIe
siècle. Certes, le genre policier historique était déjà bien implanté,
mais peu de gens connaissaient le contexte historique, social ou
religieux de ce pays à cette époque reculée. Il y avait ainsi une part
de mystère associée à cette partie du monde qui a séduit pas mal de
lecteurs. Le fait que deux sœurs, de formation scientifique, aient écrit
ensemble une histoire de crimes a également intrigué les gens, ce qui a
aidé à faire connaître le livre.
Et celui de vos parents ? Vous nous racontez l'anecdote ?
Comme nous n'étions pas sûres d'être publiées, nous avions gardé ce
travail d'écriture secret. Quand nous leur avons envoyé le livre
imprimé, nos parents ont cru sur le coup que c'était un écrivain portant
notre nom qui avait écrit l'histoire.
Dès ce premier livre, vous pensiez faire une série ou non ?
Je pense que l'idée de la série était déjà présente, car l'époque était
si riche qu'un seul livre ne suffisait pas à en décrire tous les
détails. Certainement, il y avait tout un côté exotique et pittoresque,
qui pouvait faire rêver le lecteur, mais j'y voyais aussi un
fourmillement de sujets sociaux, scientifiques, religieux, politiques
qui méritaient d'être développés. De plus, les personnages aspiraient à
prendre une épaisseur qui ne vient qu'au fur et à mesure des
tribulations : l'intérêt naît souvent de l'évolution des protagonistes
et des déchirements internes que seules des situations de crise peuvent
amener.
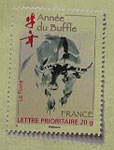 Le mandarin Tân se voit présenté de nombreuses
jeunes filles... Alors, vous qui êtes du Vietnam, de quelle province
venez-vous, êtes-vous des filles « vivant près de l'embouchure du
fleuve, les plus gracieuses », ou « celles des hautes montagnes où
poussent des aréquiers élancés à l'ombre desquels grandissent des jeunes
filles au teint clair et à la démarche souple » ?
Le mandarin Tân se voit présenté de nombreuses
jeunes filles... Alors, vous qui êtes du Vietnam, de quelle province
venez-vous, êtes-vous des filles « vivant près de l'embouchure du
fleuve, les plus gracieuses », ou « celles des hautes montagnes où
poussent des aréquiers élancés à l'ombre desquels grandissent des jeunes
filles au teint clair et à la démarche souple » ?
Question piège par excellence ! En fait, nous sommes nées à Huê, région
du Centre, loin de l'embouchure d'un fleuve, et pas tellement dans les
montagnes non plus. Certes, il y a une légende qui prétend que les
femmes de Huê sont les plus belles du pays, mais vous vous doutez bien
que ce sont les gens du coin qui la propagent !
Etes-vous du Sud où les gens sont plus raffinés comme il est dit dans «
L'aile d'airain » ?
Non, bien que mon père soit originaire du Sud, je me considère plutôt
comme quelqu'un du Centre, qui est la région de ma mère. Si j'ai laissé
entendre dans « L'aile d'airain » que les gens du Sud étaient plus
raffinés, c'est plutôt par dérision. Pour caricaturer sauvagement, on
pourrait dire que les gens du Nord, très roués et beaux parleurs,
possèdent un raffinement intellectuel indéniable. Les gens du Centre
sont simples, voire provinciaux. Quant aux gens du Sud, ils vivent dans
un environnement si opulent (terres fertiles, rivières poissonneuses...)
qu'ils sont plutôt bons vivants, mais d'une honnêteté qui reste à
démontrer.
Ces enfants, nommés « les rejets de l'arbre nain »... il y avait
beaucoup de laissés pour compte à l'époque ?
Les difformités, comme tous les écarts à la « normalité », posaient le
problème de « la pureté de la souche », une notion terrible et injuste,
qui fait encore des ravages aujourd'hui. De même, les montagnards,
pourtant installés depuis très longtemps sur le territoire, étaient
traités comme des bêtes et refoulés sur les hauteurs, tandis que les
Viêts s'arrogeaient les plaines. Il existait également des groupes de
gens préposés à la collecte d'ordures qui faisaient figure de parias,
ainsi que des populations d'errants.
Et ceux qui n'avaient pas de problèmes, vérifiaient-ils, en général, les
préceptes d'éducation de Monsieur Bâ « Pour les faire rentrer dans les
textes de Confucius, rien ne vaut un dressage serré. Quelques coups de
fouet ici et là, une séance de méditation sur une peau de durian bien
piquante, voilà des arguments auxquels ces pitres sont sensibles. »
Ceux qui avaient la possibilité d'aller à l'école apprenaient les textes
de Confucius, piliers de l'éducation. Les concours mandarinaux
s'appuyaient d'ailleurs sur ces classiques, que le candidat devait
commenter. Les punitions corporelles faisaient partie intégrante des
méthodes d'enseignement (mais ceci n'est pas une spécificité viêt),
parce qu'on ne remet jamais en question l'autorité du maître, lequel
peut donc choisir librement sa méthode pédagogique. Ces pratiques
musclées se poursuivaient d'ailleurs encore au XXe siècle.
Confucianisme qui était vraiment dur, d'ailleurs (il suffit de prendre
en exemple la suprématie confucianiste de l'enfant mâle)... cela a fait
souffrir beaucoup de gens ?
La suprématie de l'enfant mâle découle directement d'une pratique
essentielle pour le confucianisme : le culte des ancêtres. La cérémonie
destinée à montrer le respect qu'on a pour ses ancêtres ne peut être
conduite que par un descendant mâle. Il fallait donc donner naissance à
un garçon si on ne voulait pas finir oublié de tous. Forcément, les
filles en pâtissaient, d'autant plus qu'à leur mariage, elles
s'installaient chez leurs beaux-parents, donc se révélaient inutiles
pour leurs propres parents dans leurs vieux jours. De ce fait, les
femmes n'ayant pas de descendance mâle pouvaient être répudiées par leur
mari, sans que cela choque quiconque.
Et cette société rigide « une place définie pour chaque homme, une
fonction immuable qui s'emboîte précisément dans l'édifice global [...]
L'ordre du monde est établi grâce au rôle déterminé pour chaque
individu, de l'Empereur jusqu'au simple sujet »...
L'ordre établi était aussi quelque chose de difficile à supporter.
Incontestablement, ce principe, qui définit un individu par le biais à
sa relation à autrui, a contribué à asseoir une société solide, comme en
Chine. Mais à force de brimer l'individu, on en est venu à scléroser
tout l'édifice : manque d'imagination dans les réformes, immobilisme
politique...
« Les monstres ne sont pas ceux qui sont laids extérieurement, mais ceux
qui portent en eux un cœur pourri », dit si justement Madame Jade,
êtes-vous d'accord avec elle ?
Bien entendu. Cette remarque fait justement référence à cette notion de «
pureté de la souche » que j'évoquais plus haut. Aujourd'hui encore,
beaucoup de Viêts croient à l'existence de la pureté de la lignée. Cette
notion entre en jeu au moment des mariages : on s'intéresse - non pas à
la future mariée ou au futur marié - mais à sa famille. Si par malheur
un homme compte un criminel, un ivrogne, un adultère parmi ses ancêtres,
il hérite du label « Mauvaise souche », et alors il pourra toujours
courir après sa dulcinée. Cela signifie que l'individu porte la
responsabilité des actions de ses ancêtres, ce qui est évidemment
absurde et injuste. Pour moi, cette croyance dans un déterminisme
génétique est l'apanage de ces monstres au cœur pourri.
En parlant de monstres, les rats à « l'anus cousu »... il y avait le
même raffinement que chez l'ennemi chinois dans les tortures diverses et
variées ?
Je pense que les tortionnaires, de tous temps et en tous lieux, sont des
génies de l'invention quand il s'agit de concocter des supplices.
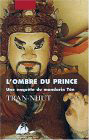 L'ombre du prince
L'ombre du prince
On reste un peu sur les monstres avec des gens capables de dresser des
éléphants pour tuer, non ?
Surtout quand on les dresse pour tuer des femmes adultères...
La médecine traditionnelle y est beaucoup présente (sacré docteur Porc
!), c'est une chose qui vous passionne ou vous avez juste fait beaucoup
de recherches pour le livre ?
La médecine traditionnelle est un sujet qui me passionne parce qu'elle
allie une science empirique à une poésie dans les appellations. Les noms
de plantes et de minéraux me transportent ailleurs par leurs sonorités :
l'aralie palmée, l'orpiment, le réalgar... C'est un sujet vaste, qui
permet des comparaisons intéressantes entre les différents pays (Chine,
Inde...). Une fois qu'on a établi quelques similitudes, on peut alors se
poser la question de la propagation de ces idées, ce qui ouvre un tout
nouveau champ d'études.
Et la querelle Porc/Bombyx ? Une belle empoignade historique ou un beau
morceau de fiction ?
La querelle docteur Porc / monsieur Bombyx illustre effectivement la
confrontation entre la médecine chinoise traditionnelle et une médecine
plus animiste, basée sur les esprits. J'imagine que ces courants ont dû
s'affronter à un moment où à un autre, mais j'ai idée qu'au bout du
compte, ils ont fini par se mêler, car on peut utiliser des potions
provenant de la médecine chinoise pour expulser des démons internes. En
ce qui me concerne, cette opposition entre écoles était exactement ce
qu'il me fallait pour me défouler à la fin de l'histoire.
« Ventru et trapu, je vous servais tous les
jours.
Aujourd'hui je répands des jets d'ambre
Tièdes, inopinés, capricieux .
Ah, maîtres, vous me trouvez
Sans ma petite chose
Inutile et pitoyable »... ces petites devinettes, c'est vous qui les
écrivez ? Vous vous y amusez avec votre sœur lors de la rédaction de
vos livres ?
Oui, nous les inventons pour témoigner du côté occasionnellement grivois
de l'esprit viêt (et de l'esprit des auteurs), et pour piéger un peu le
lecteur.
Les mandarins qui cherchent la solution entre justice et équité... vous
qui avez fait des recherches pour vos livres, était-ce vraiment une des
préoccupations mandarinales ?
Par définition, un mandarin se doit d'être juste et équitable envers le
peuple ; c'est même sa raison d'être. Le système confucéen, dont un
mandarin est issu, exige de lui probité et retenue. Cependant, dans les
faits, beaucoup de mandarins ont abusé de leur pouvoir, et ont commis
des exactions envers le peuple qu'ils étaient censés défendre,
s'attirant ainsi la haine des gens. Au moment où le mandarin Tân entame
sa carrière, la situation s'est détériorée. Les paysans, exploités par
les princes et les magistrats, vivent des moments tragiques. Le dilemme
du mandarin est le suivant : fils de paysan, jusqu'où pourra-t-il faire
appliquer une justice qui bafoue les siens ?
En parlant de recherches historiques, on voit, à l'époque, des
préoccupations écologiques, des soucis avec les inondations... cela
revient dans votre documentation ?
Les inondations du Fleuve rouge dans la région de Thang Long (l'actuelle
Hanoi) sont une réalité. On s'en rend compte encore de nos jours. Pour
le peuple, crues et sécheresses dénotent un dysfonctionnement du monde,
imputable aux mauvaises actions du monarque et pouvant justifier une
révolution. La société des hommes devient ainsi indissociable de la
nature elle-même.
Sans dévoiler l'intrigue, est-ce le Système des Classifications, ces
Cinq Eléments qui sont à la base de votre roman ?
C'est un des sujets clé du roman, car ce système de Classifications a
trait à l'harmonie de l'univers, avec toutes les implications politiques
et sociales qui en découlent.
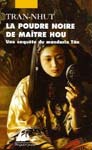 La poudre noire de Maître Hou
La poudre noire de Maître Hou
Cette troisième aventure a été élaborée à deux mais vous l'avez écrite
seule... Pourquoi ?
Pour une question de rythme d'écriture : comme j'écris plus vite que
Kim, j'étais impatiente d'avancer, et j'ai préféré prendre les devants
pour tout écrire moi-même.
« L'armée des ombres », met en évidence les croyances, superstitions et
autres choses fantastiques qui parsèment vos livres... ça vous plait
bien toutes ces histoires ?
Le fantastique m'a toujours plu, car il fait appel à des peurs
ancestrales, des phobies en tous genres, et mêle de façon intime la vie
et la mort. Les superstitions révèlent la partie primitive de l'esprit
humain, c'est ainsi que d'un pays à un autre, on peut retrouver des
superstitions similaires. Par bonheur, il se trouve que le polar permet
d'intégrer dans la narration ces recoins obscurs de notre conscience, ce
qui donne une dimension supplémentaire à l'intrigue.
Dans cet épisode arrive un jésuite français ? C'est pour vous
l'occasion d'encore plus croiser les différentes visions du monde
(Taoïsme, Confucianisme...) et l'avancée des sciences ?
Parfaitement. C'était l'occasion rêvée pour mettre en regard différents
courants philosophiques et religieux. L'Asie connaissait jusqu'alors le
confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme - des pensées qui
coexistaient sans trop de heurts, ce qui était remarquable. Mais voilà
que des missionnaires débarquent pour tenter de convertir la population
au catholicisme, une religion plus stricte et surtout une religion
monothéiste. Cette nouvelle vision des choses allait à l'encontre du
culte des ancêtres et mettait en péril toute la cohorte des divinités
taoïstes, d'où un conflit évident. Mais les jésuites sont aussi connus
pour leur excellence dans les domaines scientifiques. Le jésuite
français est donc un personnage amoureux des sciences et curieux de leur
état d'avancement en Asie. Par le biais de ses réflexions, le lecteur
peut se rendre compte que beaucoup d'inventions technologiques et de
théories scientifiques existaient déjà en Asie, bien avant leur
découverte par des Européens.
Comme le dit le lettré Dinh, le Mandarin Tân est « facilement ému par la
beauté d'une femme »mais... Il est toujours célibataire et on ne lui
connaît aucune aventure... est-ce lié à son rang ? A un amour de
jeunesse brisé ?
Je crois que c'est surtout lié à sa maladresse !
Il y a toujours un humour léger dans vos livres et un plaisir à écrire
des petites scènes « équivoques » comme celle du docteur Porc dont le
patient a le poignet qui ne peut se dresser... Alors, on s'amuse en
écrivant ?
S'amuser en écrivant - il n'y a que ça de vrai.
Toujours sans dévoiler l'intrigue, « La poudre noire de Maître Hou »...
où avez-vous entendu parler de ses propriétés ?
Dans « L'Aconit et l'orpiment » de Frédéric Obringer, un excellent livre
qui traite de la médecine chinoise.
L'ouverture au monde et l'arrivée des européens avec leurs comptoirs et
missions... C'est le début d'une grande mutation au Dai-Viêt... « Pour
l'heure, le pays était à l'abri. Mais pendant combien de temps encore ?
» Vous nous en dites quelques mots ?
Le XVIIe siècle a vu l'arrivée des premiers européens, qui se sont rendu
compte des richesses naturelles du pays. La tentation était grande d'en
tirer profit. Tant que le commerce des bois précieux, des métaux,
etc... restait sous le contrôle de l'Empereur, l'argent ne quittait pas
le pays. Mais parce que la guerre civile entre les seigneurs du nord et
ceux du sud a mené à la colonisation française, ces ressources ont été
massivement exportées.
 L'aile d'Airain
L'aile d'Airain
On reste dans les problèmes politiques et de territoires avec Les
Cham... vous nous en dites quelques mots...
Les Cham étaient un peuple dont le territoire jouxtait le Dai Viêt. Leur
civilisation, influencée par l'Inde, n'avait pas beaucoup à voir avec
celle des Viêts, issue de la Chine, d'où un conflit idéologique à la
base. Ces deux royaumes ont toujours été en guerre : suivant les
périodes, les Cham mettaient à sac la capitale viêt, ou alors les Viêts
envahissaient le pays cham. Or, pendant la guerre civile, le seigneur
Nguyên avait besoin d'étendre son emprise vers les terres du sud. Après
sa victoire sur le seigneur Trinh du nord, il a fini par annexer le
Champa au Dai Viêt, effaçant du coup ce pays de la carte. Aujourd'hui,
des ruines cham près de Da Nang témoignent encore de cette civilisation
disparue.
Ce 4ème volet est purement de vous... Alors, quel effet ça fait de se
retrouver seule ?
C'était la liberté intégrale ! J'apprécie beaucoup le fait de pouvoir
travailler à mon rythme et de tout construire de bout en bout. Il y a
certes des moments de doute et de solitude, mais en fin de compte, c'est
peu comparé à l'exaltation générale.
Il est toujours signé Tran-Nhut alors que pour la jeunesse, Kim met son
prénom en couverture... Vous n'êtes pas fâchées, au moins ?
Non, pas du tout fâchées. Kim met son nom en couverture pour dissocier
les livres pour la jeunesse des enquêtes du mandarin Tân. Je pense que
c'est mieux comme cela, car les lecteurs du mandarin sont habitués à «
Tran-Nhut » depuis le début.
Ce qui est stupéfiant, c'est la résolution de l'énigme qui cette fois-ci
repose sur les escargots (pour faire bref)... alors, certes, en
appendice, vous nous dites d'où ça vient... mais à quel moment, en
lisant cette maladie, vous dites-vous : tiens, mais je pourrais en tirer
une intrigue ?
Au cours de mes lectures, je garde toujours en tête les thèmes qui
m'intéressent : médecine, sciences, religion... - une sorte de veille
permanente, si vous voulez. Cela me permet de voir assez rapidement les
sujets que je pourrais utiliser par la suite.
L'archiviste : « J'ai développé un principe inviolable de rangement qui
s'appuie sur des phénomènes aléatoires »... un homme qui fait frémir une
scientifique comme vous, non ?
Effectivement. Le désordre semi organisé, ou l'ordre chaotique, c'est
mortel pour les rangements.
Des oiseaux qui parlent et qui répètent les conversations... n'y
allez-vous pas un peu fort ?
Pour les conversations, j'invoque la licence poétique. En revanche, au
Viêt-Nam on élève des oiseaux qui arrivent à répéter des phrases
entières, avec un très bon accent en plus.
Les indiens qui vérifient l'efficacité du citragandha, réputé pour ses
vertus hémostatiques » : cela « consiste à couper le pied à un enfançon.
Après quoi on lui administre la drogue et on lui demande de marcher sur
le pied. S'il est capable de se délacer à l'instant même, c'est que la
marchandise est de bonne qualité »... C'est un exemple lu ?
J'ai tiré cette information du livre « The Golden Peaches of Samarkand »
d'Edward Schafer, que j'avais cité dans l'appendice de « La Poudre
noire de Maître Hou ». C'est un ouvrage remarquable sur l'époque des
T'ang en Chine.
On parlait de techniques de combat plus haut... La bataille homérique
entre instruments de torture et fruits/légumes/chapelet de saucisse...
vous vous êtes bien amusée, non ?
Comme toujours ! Cela montrait bien la capacité d'improvisation du
mandarin Tân, un Mac Gyver avant l'heure, en quelque sorte.
Beaucoup plus que la guerre et ses méfaits évoqués un peu plus loin...
Il faut alterner les moments légers et les moments plus sérieux, sinon
on risque de lasser le lecteur.
Plus légèrement, les histoires de Tige qui parsèment le livre... Alors,
on se laisse aller en l'absence de sa sœur ?
C'est évident ! Mais après, il faut aussi assumer...
Et pour finir, quels sont vos projets à venir ?
Je viens de terminer la 5e enquête du mandarin Tân (sortie prévue en
septembre 2005), qui se déroule à Faifo, l'actuelle Hôi An. Au XVIIe
siècle, c'était un port très important, qui accueillait non seulement
des Européens, mais aussi des Asiatiques. Hôi An, aujourd'hui classée
patrimoine mondial de l'UNESCO, est très connue des touristes, car elle a
gardé l'architecture d'époque : maisons chinoises, pont japonais. Bien
sûr, quand le mandarin Tân fait halte dans la ville, il y découvre des
choses très étranges...
Pensez-vous écrire un jour autre chose que les aventures du Mandarin Tân
?
Cela me plairait bien d'écrire un roman policier dans la France
contemporaine.
Merci bien
Interview réalisée par Christophe Dupuis, en 2005, par courriel.
Tous droits réservés, reproduction même partielle interdite.
 Fils RSS
Fils RSS